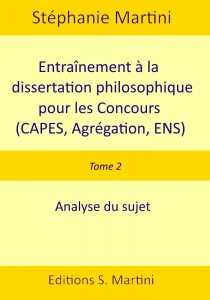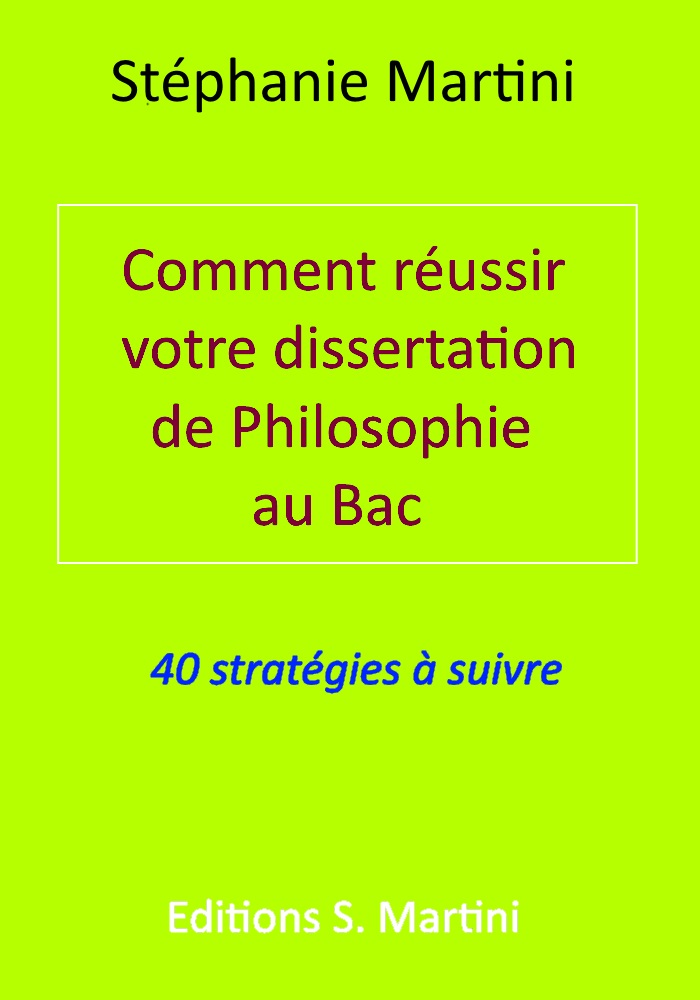Dans ce nouvel article, je vous donne les textes (sujet n°3) qui sont tombés à l’épreuve de philosophie, dans les centres étrangers, tout récemment. Mon propos n’est pas de faire une explication de texte, pour chaque (!), mais de vous en indiquer les grandes lignes de compréhension, les points importants à expliquer et aussi les erreurs à ne pas commettre.
Si vous êtes intéressés par les dissertations, je vous invite à consulter mes deux précédents articles ! (article n°1 et article n°2).
Centres étrangers : Afrique, Europe
Série L :
Texte de Popper extrait du livre : Le sens de l’écriture de l’histoire, 1962
Notions du programme abordées : l’histoire, le droit et la justice, l’Etat, le désir, le langage, la société, la liberté, l’interprétation.
« Ni la nature ni l’histoire ne peuvent nous dire ce que nous devons faire. Les faits, qu’ils soient naturels ou historiques, ne peuvent pas prendre de décisions à notre place, ils ne peuvent pas déterminer les buts que nous allons choisir. C’est à nous qu’il revient d’introduire buts et sens dans la nature et dans l’histoire. Les hommes ne sont pas égaux entre eux, mais nous pouvons décider de lutter pour l’égalité des droits ; les institutions humaines, comme par exemple l’Etat ne sont pas rationnelles; mais nous pouvons décider de lutter pour les rendre plus rationnelles. Nous-mêmes, avec notre langage, sommes grosso modo plus émotionnels que rationnels ; mais nous pouvons essayer de nous montrer un peu plus rationnels, et nous pouvons nous exercer à employer notre langage, non comme un moyen d’expression, (…) mais comme un moyen de communication rationnelle. L’histoire elle-même, j’entends ici bien sûr l’histoire de l’hégémonie (1) et non celle inexistante du développement de l’humanité, n’a ni but ni sens ; mais nous pouvons décider de les lui conférer tous les deux. Nous pouvons en faire une lutte pour la société ouverte (2) et contre ses ennemis, et nous pouvons l’interpréter en conséquence. En fin de compte, on peut dire de même du « sens de la vie ». C’est à nous qu’il incombe de décider du but de notre vie et de déterminer nos objectifs.
Je considère ce dualisme des faits et des décisions comme fondamental. Les faits n’ont pas de sens en soi ; seules nos décisions peuvent leur en conférer un. »
(1) hégémonie : domination.
(2) société ouverte : société respectueuse des libertés individuelles et collectives.
Mes remarques sur le texte : c’est un texte dense, qui foisonne d’idées et demandait, pour être bien expliqué, des connaissances, sur diverses notions (cf. plus haut). La difficulté consistait à ne pas perdre le fil directeur de l’explication (l’enjeu du texte), tout en justifiant des affirmations que Popper tient ici pour établies (ex : l’irrationalité de l’Etat, l’inégalité entre les hommes, le fait que l’homme est plus émotionnel, que rationnel, le fait que l’histoire ne consiste pas dans un développement de l’humanité, etc.)
Une façon de problématiser le texte pouvait consister à articuler deux notions centrales : celle d’histoire (cf. le titre du livre) et de liberté (cf. la notion de « décision », qui revient tout au long du texte).
En effet, si l’on part de l’idée qu’il existe une finalité dans la nature et dans l’histoire (ce que Popper conteste ici), alors il faut admettre que l’homme n’est pas libre, car réduit à suivre cette finalité. Par contre, si cette finalité est décidée par les hommes eux-mêmes (dualité entre les faits, qui par eux-mêmes ne signifient rien et les décisions), alors la liberté humaine est par là même sauvée et affirmée.
Série ES :
Texte de Locke extrait de L’essai sur l’entendement humain, 1689
Notions du programme abordées : le langage, (la liberté), (la société)
« Les mots, par l’usage courant et répété qui en est fait, en viennent (…) à susciter certaines idées avec une telle régularité et une telle facilité que les gens ont tendance à supposer entre mot et idée une liaison naturelle. Mais les mots ne signifient que les idées particulières des gens, et cela par une institution tout à fait arbitraire , ce que met en évidence le fait que souvent ces mots ne peuvent provoquer chez d’autres (même s’ils parlent la même langue) les idées dont ils sont censés être les signes. Tout homme a la liberté inviolable de donner aux mots la signification qu’il veut, au point que personne n’a le pouvoir de faire que les autres qui utilisent les mêmes mots aient dans l’esprit les mêmes idées que lui.
Ainsi, même le grand Auguste(1), ayant acquis le pouvoir de commander au monde, reconnaissait-il qu’il ne pouvait créer un nouveau mot latin, ce qui revenait à dire qu’il ne pouvait arbitrairement définir quelle idée serait signifiée par un signe dans la bouche et le langage commun de ses sujets. »
(1) Auguste : empereur romain.
Mes remarques sur le texte : ce passage était court et ses articulations (mouvement de la réflexion) bien marqués (« mais »… »ainsi »). La thèse de Locke n’était cependant pas si évidente qu’il n’y paraissait : en effet, après avoir rejeté le lien supposé naturel entre le mot et l’idée qu’il signifie, Locke en vient à affirmer (en toute logique) qu’un tel lien n’est que pure convention. Cependant, cette convention n’est pas générale, comme on pouvait s’y attendre, mais reste particulière. Mais si chacun a la liberté de donner aux mots la signification qu’il veut, comment peut-on encore parler d’un langage commun entre les hommes ?
Comme le texte était assez court, il fallait, pour étoffer l’explication, aller jusque dans les détails du texte : par exemple, aller jusqu’à expliquer la différence entre « courant » et « répété », dès la première phrase. Bien entendu, il ne fallait pas, en même temps, noyer l’explication d’ensemble dans des détails, mais bien garder à l’esprit le fil conducteur du texte, tout au long de son explication. De même, un travail sur les sens des termes « mots », « idées » et « signification » était ici nécessaire, pour clarifier l’explication.
Série S :
Texte de Russell, extrait de l’Analyse de l’esprit, 1921
Notions du programme abordées : le désir, la conscience, l’inconscient.
« Pour ce qui est de nos propres désirs, la plupart des gens croient que nous pouvons les connaître par une intuition immédiate, qui ne dépend pas de l’observation de nos actes. Si, cependant, il en était ainsi, comment expliquerait-on qu’il y ait tant de gens qui ne savent pas ce qu’ils désirent ou qui se trompent sur la nature de leurs désirs ? C’est un fait d’observation courante, qu' »Untel ignore ses propres mobiles » ou que : « A est jaloux de B et malveillant à son égard, mais sans en être conscient ». On dit de ce gens qu’ils se trompent eux-mêmes et l’on suppose qu’ils se sont livrés à un travail plus ou moins compliqué, ayant pour but de dissimuler à eux-mêmes des choses dont l’évidence, sans cela, sauterait aux yeux. C’est là, à mon avis, une manière de voir tout à fait fausse. Je crois que la découverte de nos propres mobiles ne peut se faire que de la même manière que celle dont nous découvrons les mobiles des autres, à savoir par l’observation de nos actions, celles-ci nous permettant ensuite de conclure aux désirs qui les inspirent. Un désir est conscient, lorsque nous nous sommes dits à nous-mêmes que nous l’éprouvons. Un homme ayant faim peut se dire : « Je voudrais bien déjeuner. » Alors son désir est conscient. Il ne diffère d’un désir inconscient que parce qu’il est formulé à l’aide de mots appropriés ; mais cette différence est loin d’être fondamentale. »
Mes remarques sur le texte : il fallait tout d’abord bien repérer sa construction : Russell commence par exposer une thèse courante (« la plupart des gens croient que… ») sur la façon de prendre conscience de nos désirs, thèse qu’il rejette, en lui objectant deux faits d’observation (« comment expliquerait-on que… »). Cependant, il commence par étudier ces deux faits à la lumière de l’explication de ses « adversaires » (« on dit que… »), pour enfin, à nouveau, exposer sa propre thèse (« C’est là, à mon avis, une manière de voir tout à fait fausse »).
De plus, la fin du texte comportait quelques pièges : à la lecture du mot « désirs inconscients », il ne fallait surtout pas vous lancer, dans la thèse de Freud, sur les désirs refoulés dans l’inconscient ! Et puis, la remarque finale « cette différence est loin d’être fondamentale » était pour le moins assez énigmatique et demandait que l’on s’efforce de l’expliquer et non que l’on passe sur la difficulté !
Par contre, la problématisation du texte était assez facile. On pouvait en effet s’étonner que le désir étant un ressenti, un manque qui déclenche une action, pour être satisfait, puisse rester inconnu, inconscient à la personne même qui agit. La thèse de Russell consistait alors à rejeter la connaissance du désir par l’intuition immédiate, mais à partir du point d’arrivée (l’action), pour remonter jusqu’à ses mobiles, jusqu’au désir.
Série STMG-STI :
Texte de Rousseau, extrait de Emile ou de l’éducation, 1762
Notions du programme abordées : le bonheur, la liberté, la culture.
« Avant que les préjugés et les institutions humaines aient altéré nos penchants naturels, le bonheur des enfants ainsi que des hommes consiste dans l’usage de leur liberté ; mais cette liberté dans les premiers est bornée par leur faiblesse. Quiconque fait ce qu’il veut est heureux, s’il se suffit à lui-même ; c’est le cas de l’homme vivant dans l’état de nature; quiconque fait ce qu’il veut n’est pas heureux, si ses besoins passent (1) ses forces : c’est le cas de l’enfant dans le même état. Les enfants ne jouissent même dans l’état de nature que d’une liberté imparfaite semblable à celle dont jouissent les hommes à l’état civil (2). Chacun de nous, ne pouvant plus se passer des autres, redevient à cet égard faible et misérable. Nous étions faits pour être hommes ; les lois et la société nous ont replongés dans l’enfance. Les riches, les grands, les rois sont tous des enfants qui, voyant qu’on s’empresse à soulager leur misère, tirent de cela même une vanité puérile, et sont tout fiers des soins qu’on ne leur rendrait pas s’ils étaient hommes faits (3). »
(1) passent : dépassent.
(2) « Etat civil » : par opposition à l’état de nature, désigne la vie sociale et politique.
(3) « hommes faits » : adultes.
1) Dégagez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie.
2) a) Expliquez : « quiconque fait ce qu’il veut n’est pas heureux, si ses besoins passent ses forces ».
b) Expliquez : « nous étions faits pour être hommes, les lois et la société nous ont replongés dans l’enfance ».
3) Faut-il se suffire à soi-même pour être heureux ?
Esquisses de réponses aux questions :
1) Les hommes, étant dépendants les uns des autres, dans la société, ne jouissent donc pas de la liberté pour laquelle ils étaient faits.
Rousseau établit sa thèse, en comparant l’état de nature et l’état civil (la société), ainsi que l’homme adulte et l’enfant. Dans l’état de nature les hommes se suffisent à eux-mêmes, alors que dans la société, ils deviennent interdépendants. Ainsi, les hommes adultes, dans la société, sont comparables à des enfants, à l’état de nature. Ceci est particulièrement vrai des « plus puissants », dont le pouvoir sur les autres consiste en réalité à se faire assister.
2) a) Rousseau établit un rapport entre la liberté (faire ce que l’on veut) et le bonheur. Etre libre ne suffit pas, car si nos besoins (qui sont plutôt ici des désirs) dépassent notre capacité à les satisfaire, alors nous aurons besoin de l’assistance des autres et donc nous perdrons notre liberté (autonomie).
b) la nature nous fait passer de l’état de l’enfance (dans lequel nous sommes dépendant des autres, pour la satisfaction de nos besoins) à l’état d’adulte (dans lequel nous devenons autonomes). Or, la société nous rend interdépendants, car elle suscite en nous des besoins qui dépassent nos forces seules pour les satisfaire.
3) Il fallait bien analyser les termes du sujet : « faut-il… pour » (nécessité conditionnelle), « se suffire à soi-même » (quel est le sens de cette expression ?) et « être heureux » (jouer ici sur les différentes conceptions du bonheur). L’enjeu du sujet consistait à se demander si « suffire à soi-même » exigeait d’être seul (isolé des autres) et alors à savoir si nous pouvions être heureux, sans les autres. Ou bien si une forme d’autonomie était possible, tout en étant avec les autres (indispensables à notre bonheur).
Centres étrangers : Amérique du Nord
Série L :
Texte de Rousseau, extrait du Discours sur l’économie politique, 1755
Notions du programme abordées : l’Etat, le devoir, la justice et la loi, la société, la liberté.
« Le plus pressant intérêt du chef, de même que son devoir le plus indispensable, est de veiller à l’observation des lois dont il est le ministre (1) ; et sur lesquelles est fondée toute son autorité. S’il doit les faire observer aux autres, à plus forte raison doit-il les observer lui-même qui jouit de toute leur faveur. Car son exemple est de telle force, que quand même le peuple voudrait bien souffrir (1) qu’il s’affranchît du joug de la loi, il devrait se garder de profiter d’une si dangereuse prérogative, que d’autres s’efforceraient d’usurper à leur tour, et souvent à son préjudice. Au fond, comme tous les engagements de la société sont réciproques par leur nature, il n’est pas possible de se mettre au-dessus de la loi sans renoncer à ses avantages, et personne ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à personne. Par la même raison, nulle exemption de la loi ne sera jamais accordée à quelque titre que ce puisse être dans un gouvernement bien policé (3). Les citoyens mêmes qui ont bien mérités de la patrie doivent être récompensés par des honneurs et jamais par des privilèges : car la république est à la veille de sa ruine, sitôt que quelqu’un peut penser qu’il est beau de ne pas obéir aux lois. »
(1) ministre : serviteur.
(2) souffrir : accepter.
Mes remarques sur le texte : la question « classique » que se pose Rousseau est de savoir si l’on peut faire exception à la loi. La réponse négative qu’il donne est catégorique et s’articule en deux temps : il commence par traiter du cas du ministre de la loi (lequel, par le poste qu’il occupe, est le mieux placé pour être « au-dessus » des lois), afin de justifier la réponse à la question, au niveau des citoyens (« Par la même raison… »).
Cette question pouvait être problématisée de la manière suivante : comment persuader un citoyen ou un ministre de la loi de la respecter et de jamais lui désobéir, dans la mesure où chacun y désobéit par intérêt personnel ? La réponse de Rousseau consiste à montrer qu’au contraire, faire exception à la loi, c’est aller contre son propre intérêt personnel.
Ce texte, qui consiste, la plupart du temps, à enchaîner des affirmations, se prêtait donc bien à un travail d’argumentation (à savoir de justification des affirmations de l’auteur). Encore fallait-il ne pas se laisser impressionner par le style rhétorique de Rousseau (par exemple : « personne ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à personne ») !
Série ES :
Texte de John STUART MILL, extrait de Considérations sur le gouvernement représentatif, 1861
Notions du programme abordées : l’Etat, la politique, la liberté, le travail, la culture.
« Il est particulièrement décourageant pour un individu, et plus encore pour une classe (1), d’être laissé hors de la constitution (2) : d’en être réduit à plaider sa cause à la porte des arbitres de sa destinée, sans pouvoir participer à la consultation. L’effet dynamisant de la liberté sur le caractère n’atteint son niveau maximal que lorsque la personne en question est soit dotée des mêmes privilèges de la citoyenneté que les autres, soit en passe de l’être. Est même plus importante encore que cette question de sentiment la discipline pratique que les citoyens acquièrent, au niveau de leur caractère, lorsqu’ils sont appelés occasionnellement, pour un temps et chacun à leur tour, à exercer quelque fonction sociale. On ne prend pas suffisamment en compte que, dans la vie ordinaire de la plupart des hommes, rares sont les occasions d’élargir leurs visions et leurs sentiments. Leur travail n’est que routine ; commandé non par l’amour mais par la forme la plus élémentaire de l’intérêt personnel, soit la satisfaction des besoins quotidiens : ni l’objet de ce travail ni le processus lui-même n’ouvrent l’esprit sur des pensées ou des sentiments qui les portent au-delà d’eux-mêmes. S’ils ont à la portée de main des livres instructifs, rien ne les conduit à les lire ; et le plus souvent l’individu n’a pas accès à quelque personne ayant une culture supérieure à la sienne. Lui donner une tâche à accomplir pour le public corrige dans une certaine mesure toute ces déficiences. Si les circonstances permettent que soit considérable la somme des devoirs publics qui lui sont assignés, cela fera de lui un homme éduqué. »
(1) Classe : groupe d’individus ayant des intérêts communs.
(2) Etre laissé hors de la constitution : ne pas être associé à la vie politique.
Mes remarques sur le texte : la thèse développée ici est particulièrement originale. En effet, Stuart Mill ne justifie pas la démocratisation de la politique, au nom des droits de l’homme – comme c’est souvent le cas, mais en montrant son effet bénéfique sur l’éducation et la culture de l’individu.
Il fallait donc bien expliquer en quoi le fait de donner des devoirs publics (charges politiques) à l’individu lui permet d’acquérir une éducation que son activité routinière (travail, satisfaction des besoins) ne lui permet pas d’avoir. Cependant, il ne fallait pas s’égarer, au milieu du texte, dans une critique de la vie quotidienne et du travail, au point de perdre le fil conducteur de la réflexion.
Le texte pouvait donc être problématisé de la manière suivante : comment porter l’individu au-delà de la considération de lui-même, puisqu’une société ne peut pas réellement avoir de cohésion, si chacun s’occupe uniquement de la satisfaction de ses intérêts personnels ? Le tour de force de la réponse de Stuart Mill (donner à l’individu des charges politiques) consistait à assurer la cohésion sociale, tout en permettant à l’individu d’affirmer sa liberté individuelle.
Série S :
Texte de Nietzsche, extrait de Humain trop humain, 1878
Notions du programme abordées : la morale, la justice et le droit.
« Celui qui est puni ne mérite pas la punition : on ne se sert de lui que comme d’un moyen d’intimidation pour empêcher à l’avenir certains actes ; celui que l’on récompense ne mérite pas davantage sa récompense : il ne pouvait en effet agir autrement qu’il n’a agi. Ainsi la récompense n’a d’autre sens que d’être un encouragement pour lui et pour les autres, elle a donc pour fin de fournir un motif à de futures actions : on acclame celui qui est en train de courir sur la piste, non pas celui qui est au but. Ni la peine ni la récompense ne sont choses qui reviennent à l’individu comme lui appartenant en propre ; elles lui sont données par des raisons d’utilité, sans qu’il y ait à y prétendre avec justice. Il faut dire « le sage ne récompense pas parce que l’on a bien agi » de la même manière que l’on a dit « le sage ne punit pas parce qu’on a mal agi, mais pour empêcher qu’on agisse mal ». Si peine et récompense disparaissent, du même coup disparaîtraient les motifs les plus puissants qui détournent de certaines actions et poussent à certaines autres ; l’intérêt de l’humanité en exige la perpétuation. »
(1) Perpétuation : maintien.
Mes remarques sur le texte : les textes de Nietzsche déconcertent souvent, dans la mesure où il aime à prendre le contrepied des thèses établies. Ainsi, ce texte ne fait pas exception : on y trouve de nombreuses phrases à tournure négative, qui expriment ce qu’il ne faut surtout pas penser sur le sujet, dont il traite !
Le sujet du texte est somme toute assez vague, puisqu’il s’agit de la récompense et de la punition, sans qu’en soient précisés les champs d’application : s’agit-il de la récompense accordée au sportif, de la punition infligée à celui qui ne respecte pas la loi juridique ou la loi morale ?
Ainsi, une explication réussie devait permettre de préciser ce qui ne l’était pas dans le texte, tout en couvrant le maximum de champs d’applications possibles !
La thèse de Nietzsche était cependant assez facile à établir : la récompense et la punition ne reposent pas sur la justice, le mérite, mais sur l’utilité commune.
Pour problématiser cette thèse, on pouvait se demander comment la société fait-elle pour assurer l’intérêt collectif, alors que chaque individu est mû par son intérêt personnel. La réponse consistait à montrer que la société se sert des motifs égoïstes de l’individu, en lui donnant l’illusion que sa récompense ou son châtiment sont mérités.
Série STMG-STI :
Désolée, je n’ai pas pu trouver le sujet qui est tombé ! Si vous le connaissez, faites m’en part !